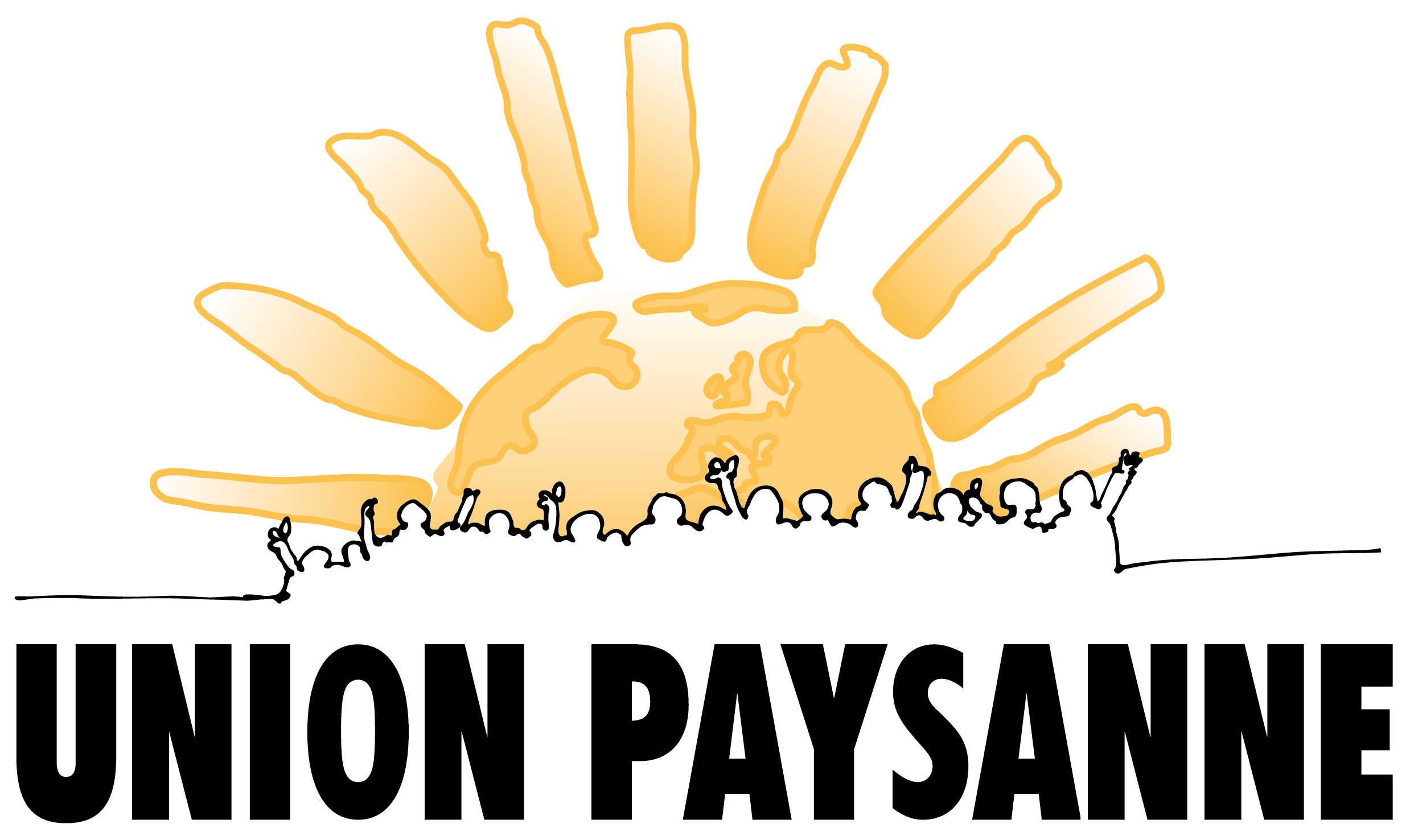Les circonstances actuelles ramènent à l’avant-scène cette idée d’autonomiser notre production alimentaire. Doit-on se surprendre qu’il ait fallu une pandémie mondiale et que soient exposées de façon crue les limites de la globalisation économique pour que l’élite dirigeante arrive à le comprendre? Non. La transcendance du capitalisme les rend aveugles. Que cette cécité conservatrice soit volontaire ou non, il vaut au moins de rappeler que maintes organisations (tel que l’Union paysanne) sonnent l’alarme depuis plus de vingt ans sur les dangers que pose une alimentation néolibéralisée pour les populations.
Or, la souveraineté alimentaire est effectivement amenée à l’ordre du jour. Enfin! Depuis la dernière semaine, nombreux sont les textes qui abordent le sujet et qui laissent entendre que la situation nous oblige à y réfléchir, ouvrant la porte à un vent d’espoir qui m’est pourtant difficile de vraiment sentir. En fait, le scepticisme que j’exprime appelle à se mettre en garde : comment une « souveraineté » alimentaire peut-elle être appliquée par des gouvernements qui font de la stabilité du capitalisme leur dessein premier? Comment la souveraineté alimentaire est-elle fondamentalement incompatible avec les mécanismes de ce système économique, même si on le sort de la mondialisation?
J’aimerais avancer ces deux idées : (1) que si la « souveraineté alimentaire » est imposée par l’élite dirigeante, c’est que le terme aura été galvaudé, qu’il s’agira au mieux d’une sorte d’autonomie alimentaire canadienne orchestrée par des intérêts privés, contribuant une fois de plus à enrichir quelques actionnaires privilégiés et ne réglant que partiellement l’insécurité alimentaire latente. Ensuite, (2) qu’il est absolument nécessaire d’abroger la Loi sur les producteurs agricoles (P-28), plus spécifiquement l’Article 8, qui autorise l’existence d’un seul syndicat agricole à la fois (en l’occurrence, l’Union des producteurs agricoles). Par là, j’aimerais amener l’idée que la pluralité syndicale est absolument nécessaire à l’orchestration d’une souveraineté alimentaire.
Quelle souveraineté alimentaire?
Récemment, Trump a réussi à bouleverser les consciences lorsqu’il a décidé d’utiliser ses pouvoirs pour que des masques N95 soient retenus aux États-Unis : un scénario indiquant que de telles mesures pourraient aussi s’appliquer aux marchandises alimentaires. Dans la tourmente, citoyens et gouvernements ont scandé leur mépris à l’égard de la figure première du protectionnisme. Comment ose-t-il? Jusqu’où cette décision peut-elle nous projeter? Soudainement, les limites imposées par le capitalisme mondialisé et l’interdépendance des économies se sont affichées concrètement aux yeux de plusieurs : la dépendance nous rend vulnérables… il est dorénavant impératif d’autonomiser notre production!
Et c’est là où la souveraineté alimentaire surgit : au moment où l’élite dirigeante semble peu à peu comprendre la faillibilité du système qu’elle protège, rendant évidente l’étroitesse de son esprit inapte à prévoir un coup à l’avance. Mais de quelle souveraineté alimentaire peut-on véritablement parler?
Il faut remonter quelques décennies pour découvrir les origines de la souveraineté alimentaire. Ce concept, initialement défendu par La Via Campesina (LVC) lors du Sommet de l’alimentation organisée par la Food and Agricultural Organization (FAO) en 1996, était une réponse clairvoyante aux dérives potentielles de l’intégration des secteurs agro-alimentaires à la mondialisation néolibérale. Plutôt que de donner le contrôle de la production alimentaire aux entreprises multinationales, LVC suggérait de rapatrier le pouvoir de se nourrir aux communautés locales et d’extraire le système agro-alimentaire des mécanismes du capitalisme. Brièvement, elle stipulait que l’alimentation devait être sous contrôle collectif (laisser les populations décider de leur alimentation) en favorisant l’émergence des fermes à échelle humaine, que la production d’aliments devait être assurée par les principes de l’agroécologie paysanne (agriculture diversifiée et écologique, en opposition aux monocultures industrielles) et que la redistribution devait être réfléchie collectivement, donc que la nourriture devrait être traitée comme un bien commun plutôt que privé. Ces propositions étaient radicalement anticapitalistes et anti-néolibérales et refusaient toute forme de compromis menaçant la souveraineté des populations. De plus, elles faisaient la promotion d’un écologisme tout aussi radical, en appelant à cesser le transport des marchandises alimentaires sur des distances folles et à arrêter l’usage des ingrédients agrotoxiques dans les champs. Et c’est sans surprise que l’élite dirigeante a rejeté le concept, allant jusqu’à refuser d’écouter toutes suggestions citoyennes qui osaient mentionner les mots « souveraineté » et « alimentaire » dans une même phrase.
De retour en 2020, alors que la planète entière est plongée dans une situation d’urgence, le gouvernement Legault montre une certaine ouverture à l’autonomisation, soulevant même l’idée qu’il faudra œuvrer à créer un contexte propice à l’autonomie alimentaire. Évidemment, il se suggère pour y réfléchir et appliquer son plan encore à construire. Et ces éléments en particulier me plongent à nouveau dans un torrent de doutes et de consternations.
La bonne foi gouvernementale
Parce qu’il faut cesser de prêter la bonne foi à ces gouvernements qui sont en presque tout points responsables de la situation que nous vivons aujourd’hui. S’ils cherchent à œuvrer à une quelconque forme de souveraineté alimentaire, il s’agira certainement d’une déformation du concept : rappelons que la souveraineté alimentaire ne se prête à aucun compromis. Incompétents à subvertir leur pensée limitée par une réflexion intelligente, ces dirigeants laisseront entre les mains d’une poignée de gros joueurs privilégiés le soin d’assurer la production et la distribution alimentaire, reproduisant à échelle locale ce modèle agro-industriel néfaste. Je me permets de rappeler que malgré leur bon vouloir rhétorique, les gouvernements ont tabletté sans vergogne les recommandations du rapport Pronovost (qui implorait avec véhémence la souveraineté alimentaire), celles de la Commission sur les pesticides (qui réclamait une révision des pratiques) et toutes autres initiatives en ce genre! Ces gouvernements ont aussi appliqué cette logique avec la légalisation du cannabis : on peut contribuer à sa production, à la seule condition d’être en relation quasi intime avec les hautes instances décisionnelles!
Or, peut-on réellement croire qu’avec ses amis lobbyistes, le gouvernement proscrira les herbicides et pesticides, œuvrera à diversifier les monocultures, travaillera à augmenter le nombre de fermes, à faciliter la distribution alimentaire actuellement contrainte par toute une série de lois aberrantes? J’en doute fortement. Il ne suffit pas de parler de souveraineté alimentaire pour la rendre existante! Le vent d’espoir souffle effectivement, mais on le voit passer depuis l’autre côté de la vitre.
Taire la dissidence
On doit probablement s’attendre à des « consultations publiques ». Les gouvernements aiment montrer qu’ils ont l’oreille ouverte aux mots de leurs populations, qu’ils sont à l’écoute. Et lorsque les dirigeants entameront la discussion avec « les agriculteurs », c’est à l’Union des producteurs agricoles (UPA) qu’ils s’adresseront. Pourquoi à cette organisation? Parce que légalement, il s’agit de la seule organisation qui possède le droit de représenter l’intérêt des producteurs agricoles. Effectivement, l’article 8 de la Loi sur les producteurs agricoles (P-28) stipule :
« Lorsqu’une association qui demande l’accréditation établit son caractère représentatif et remplit les autres conditions prévues à la présente loi, la Régie doit lui conférer l’accréditation. Une seule association peut être accréditée. »
En d’autres mots, une seule organisation syndicale peut représenter l’intérêt de tous les producteurs de nourriture : cette situation n’existe qu’en un seul endroit au monde et c’est au Québec. Actuellement, et depuis toujours, cette accréditation est accordée à l’UPA, qui se défend pourtant de ne pas être un monopole syndical. Or, le producteur maraîcher qui cherche à fournir à sa communauté des aliments écologiques et l’exportateur de soja travaillant sur 450 hectares n’ont qu’une seule voix pour consolider leurs aspirations. Et c’est la loi.
Une seule voix pour les représenter tous
Depuis maintes années, l’UPA est un moteur incontestable de l’industrialisation de l’agriculture et de l’alimentation. La diminution drastique du nombre de fermes depuis les années 1970 peut lui être attribuée presque entièrement. Elle défend l’usage des herbicides et pesticides et représente un frein majeur à leur bannissement. Lorsque l’Union paysanne a voulu défendre le droit des paysans à produire plus de cent coqs à chair et cent poules pondeuses ces dernières années (augmenter la production hors-quota, dit-on), l’UPA est intervenue devant la Régie des marchés agricoles pour s’opposer à cette requête, désirant plutôt perpétuer l’oligarchie qui existe pour ces secteurs. Et de mon point de vue paysan, cent coqs à chair et cent poules pondeuses amènent des revenus qui ont à peine de quoi assurer ma survie pour un mois! L’UPA s’exprime fréquemment en faveur du libre-échange (seulement lorsqu’elle en tire avantage) pour que transite plus facilement les productions québécoises vers l’extérieur. Et dès qu’une initiative progressiste naît de la paysannerie québécoise – comme permettre l’abattage à la ferme pour accentuer l’autonomie des collectivités – qui s’impose comme force conservatrice pour taire le mouvement? L’UPA. Cette organisation « syndicale » qui agit en réalité comme un lobby faisant la promotion des intérêts de l’agro-industrie et des acteurs qui bénéficient d’un tel système.
Les producteurs agricoles ont un privilège : celui de pouvoir obtenir un crédit d’impôt qui permet le remboursement d’une partie de la taxe foncière. Néanmoins, une des conditions qui permet d’accéder à ce crédit est d’avoir acquitté sa contribution annuelle au syndicat accrédité, c’est-à-dire à l’UPA. Autrement dit, pour obtenir un remboursement provenant de fonds publics… il faut cotiser à une organisation privée, lui envoyer son argent et engraisser son compte en banque! Et ça, c’est exigible en vertu de la loi. De façon plus imagée, c’est comme si on vous obligeait à consommer chez McDonald’s pour percevoir votre versement d’assurance parentale. L’aberrance est si flagrante qu’on peine à croire qu’elle puisse exister en régime « démocratique ». Et pourtant. Comment assurer la « souveraineté » dans une démocratie déficiente?
Une souveraineté alimentaire sans souveraineté
Or, pour imposer leur « souveraineté » alimentaire, nos gouvernements consulteront « nos agriculteurs » en demandant à l’UPA ses suggestions et son avis. Ils inviteront peut-être des organisations plus petites afin de répondre à leur devoir d’écoute. Mais nul lobby n’est aussi puissant et écouté que l’UPA au Québec. À cet effet, lors de la plus récente course électorale provinciale, aucun parti n’a osé soulever cette question de la pluralité syndicale en milieu agricole. En fait, les partis se sont même rangés unanimement derrière Marcel Groleau (président de l’UPA) lors d’un point de presse pour « soutenir » l’agriculture. Aviez-vous déjà vu les partis être unanimes par rapport à un enjeu? Cela démontre toute la puissance lobbyiste de l’UPA, qui a su asseoir sa position sur des fondations confortables, légalement intouchables.
La souveraineté alimentaire, comme l’avait dit LVC il y a environ vingt-cinq ans, doit reposer sur l’agroécologie paysanne et, de surcroît, sur les petits producteurs œuvrant dans des réseaux locaux de distribution alimentaire. Le problème, c’est que ces derniers ne bénéficient d’aucune représentativité, sinon que par quelques associations et initiatives rabrouées par les gouvernements. Pour que submerge une souveraineté alimentaire véritable, il faut absolument permettre la pluralité syndicale en milieu agricole, et cela commence par l’abrogation de la Loi sur les producteurs agricoles. Car actuellement, alors que l’espoir de changement repose sur la voix des plus petits, la seule pouvant se faire entendre est celle de l’agro-industrie. Une souveraineté alimentaire où les citoyens sont extraits des processus de décision et de production n’en est pas une, car une souveraineté alimentaire sans souveraineté n’est que la perpétuation du modèle industriel à échelle diminuée.