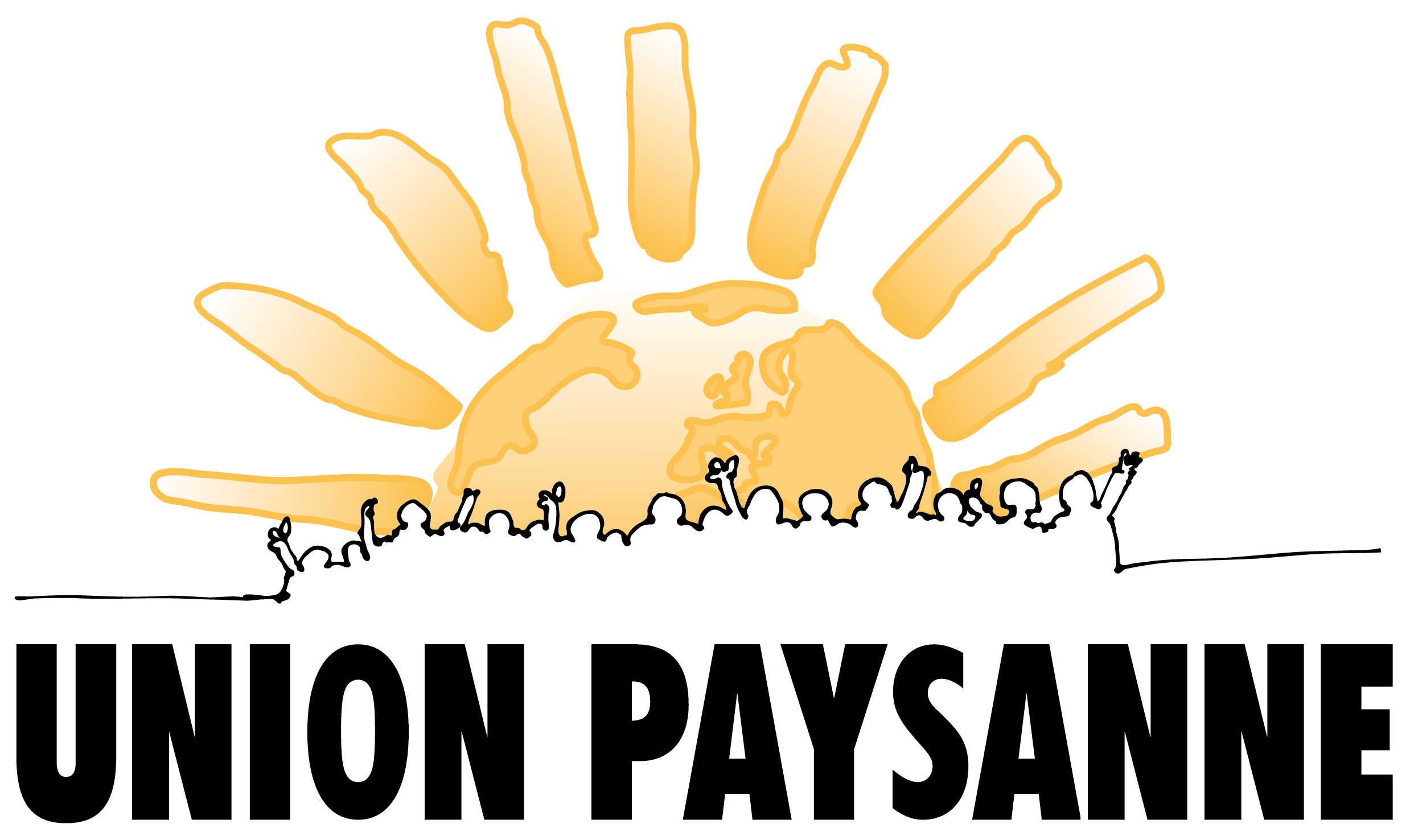Qu’on souhaite accorder aux collectivités plus d’autonomie pour accroître leur capacité à produire la nourriture et améliorer leur résilience, voilà des paroles enrobées d’un bon sens indéniable! Néanmoins, il ne suffit pas de prononcer ces vœux pour que les fermes et la production de proximité naissent et décorent soudainement le paysage agricole québécois. Maints obstacles s’érigent en freins majeurs au déploiement d’une paysannerie capable de nourrir l’ensemble de la population. Et parmi ceux-ci, on retrouve en tête de liste l’Union des producteurs agricoles (UPA), qui fait de l’agriculture industrielle la chasse gardée de notre alimentation, en prévenant son extinction par une ingérence révoltante et une rhétorique hypocrite.
Cet article s’inscrit dans la poursuite d’une ambition m’étant chère : décortiquer le système agro-alimentaire québécois afin que s’écroulent en pièces les barrières qui empêchent les collectivités d’œuvrer à l’institution d’une souveraineté alimentaire véritable. Ainsi, j’aborde ici la gestion de l’offre et quelques autres freins privant les communautés d’une autonomie alimentaire complète et démocratisée. Je soutiens aussi que pour l’atteindre, nous devrons nécessairement travailler collectivement à mettre fin au monopole syndical de l’UPA.
Être pour et contre
D’un côté, l’UPA appelle à faciliter le transfert des marchandises agricoles vers l’international, à accéder à des marchés extérieurs de consommateurs qui permettraient aux agriculteurs de faciliter l’écoulement de leurs productions et d’engendrer des profits intéressants. En ce sens, elle se positionne pour le libre-échange. Et de l’autre côté, elle se soulève violemment lorsqu’un traité économique permet aux géants étatsuniens d’importer vers le Canada des denrées alimentaires qui pourraient compromettre la production québécoise, comme c’est par exemple le cas avec l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). De cette façon, elle se positionne contre le libre-échange.
Or, elle défend et attaque simultanément la globalisation économique, démontrant risiblement les limites de sa capacité à réfléchir et à comprendre le système dans lequel elle évolue. En fait, c’est parce que ses œillères la concentrent à concevoir l’alimentation exclusivement en termes monétaires, faisant de la protection des profits son objectif premier. Et forcément, lorsque l’UPA voit en l’aliment une simple valeur d’échange (un objet de commerce) et non plus une valeur d’usage (quelque chose qui sert à nourrir), elle ne peut, sans provoquer quelques fous rires, s’affirmer comme grande protectrice de l’alimentation québécoise. Qu’elle ose maintenant le dire : l’UPA, en tant que force résolument conservatrice, ne sert qu’à protéger les acquis d’une poignée de gros joueurs. Ni plus, ni moins. Ses discours touchants sur fonds bucoliques, qui parlent d’autonomie alimentaire, de fermes à échelle humaine, etc. ne sont que poudre aux yeux, une pathétique stratégie marketing visant à se dorer d’une image immensément distante de la réalité.
Actuellement, en tant que paysan rimouskois, je suis limité à pouvoir produire trois cents coqs à chair et élever cent poules pondeuses. S’il en est ainsi, c’est parce que l’UPA et ses fédérations de producteurs l’ont décidé, à la manière d’un cartel, sans même consulter qui que ce soit. En fait, si j’aspirais à augmenter ma production, il faudrait que je me procure des quotas de production à prix exorbitants, voire prohibitifs, si bien que je devrais m’endetter et vivre avec la pression du couperet bancaire au-dessus de ma tête pour les années à venir. Et même si mes nerfs étaient assez solides pour me permettre d’aller de l’avant avec un tel projet, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce qu’il n’y a aucun quota de production présentement disponible. Et cette situation perdure depuis des années malgré la demande croissante pour ces produits : de fait, ce sont les mêmes privilégiés qui se partagent la part grandissante du gâteau. L’UPA protège les acquis d’une poignée de gros joueurs et c’est sur tous les fronts qu’elle impose sa vision.
Un quota de production n’est pas simplement un droit de produire, mais aussi (et surtout) une obligation à le faire. Les quotas s’intègrent à ce qu’on appelle la gestion de l’offre. Vouloir gérer l’offre, c’est la façon qui fut réfléchie à l’époque pour s’assurer d’un prix relativement stable. En d’autres mots, en coordonnant la quantité produite à la quantité demandée, on évite que les prix fluctuent et on stabilise le marché. Or, si un producteur détenant un quota se refuse à l’utiliser, on inflige à l’offre une diminution et on se retrouve dans la situation qu’on cherche à éviter. Les détenteurs de quota sont donc obligatoirement tenus de produire. De plus, l’offre doit rester constante à l’année, c’est-à-dire que la quantité produite ne doit pas fluctuer en fonction des saisons. C’est ce qui incite par exemple certains producteurs laitiers à garder leurs vaches dans l’étable durant l’été pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas trop productives, une « conséquence » que l’apport lumineux occasionne à l’animal. Et d’une certaine façon, c’est aussi ce qui fait que les producteurs sont contraints de jeter aux vidanges d’importantes quantités de lait : la stabilité du marché vaut bien plus que le gaspillage d’une centaine de milliers de litres de lait. Pourquoi ne pas simplement donner le lait? Parce qu’il s’agirait d’une façon trop peu stratégique de gérer l’offre.
Mais il ne faut pas non plus démoniser ce mécanisme de fixation des prix, car la gestion de l’offre s’avère un moyen tout de même efficace pour prévenir l’arrivée de joueurs surpuissants, capables, en raison d’économies d’échelle, de produire des volumes ridiculement gros à prix ridiculement bas. Gérer l’offre, c’est aussi prévenir l’invasion commerciale extérieure. Néanmoins, dans un contexte où la préservation de l’espèce humaine repose sur la souveraineté alimentaire, la gestion de l’offre (telle que pensée dans les années 1970 et inchangée depuis) s’érige comme barrière colossale à l’autonomisation des collectivités. La repenser est absolument nécessaire. Car en effet, si nous étions quelques fermes rimouskoises à vouloir produire mille poulets chacune pour nourrir les habitants des environs, nous serions dans l’illégalité, passibles d’une amende, et nos volailles risqueraient d’être saisies par la police et balancées froidement au dépotoir! Dans cette mesure, lorsque Marcel Groleau, président de l’UPA, explique que les quotas de production ne représentent qu’« un enjeu minime dans l’importance de la sécurité alimentaire », deux hypothèses doivent être émises : soit il délire, soit il protège les acquis des gros joueurs qu’il défend, et donc admet son rôle de défenseur de l’agriculture industrielle.
La réponse de l’UPA au libre-échange
J’évoquais plus tôt l’ACEUM : ce traité de libre-échange férocement défendu par Donald Trump et adopté par la Chambre des communes à la fin janvier 2020. Avant d’entrer dans le cœur de la réflexion, je souhaite indiquer quelles seront les répercussions concrètes d’un tel accord :
· « Poulet : 47 000 t la première année. Par la suite, les quantités seront augmentées annuellement de 2 000 t pour atteindre 57 000 t à la 6e année. Les volumes augmenteront de 1 %/an pendant les 10 années subséquentes.
· Œufs : 10 millions de douzaines d’œufs dès la première année. Le contingent augmentera annuellement de 1 % pendant les 10 années suivantes. »
Ces chiffres correspondent aux quantités que les géants de l’agro-industrie seront en droit d’exporter vers le Canada annuellement. Pour mieux les illustrer, les 47 000 tonnes représentent environ de 15 millions de poulets, alors que 57 000 tonnes représentent environ 28 millions de poulets.
D’emblée, l’élite politique semble très peu concernée à œuvrer à une autonomisation de notre alimentation, préférant ouvrir les valves à l’invasion extérieure de nos marchés. Évidemment, la nouvelle avait aussi été très mal reçue par l’UPA qui, reconnue comme étant pour et contre la globalisation économique, avait nécessairement la bonne carte dans son jeu pour manifester son désarroi!
En conférence de presse, où il était accompagné de trois chefs de parti, Marcel Groleau avait prévenu la population que l’ACEUM mettait notre alimentation en danger. Se portait-il alors à la défense de l’agriculture québécoise? Non! Encore une fois, il prenait sa tribune en or pour embellir l’image de son organisation. Parce qu’en vérité, ce n’est pas l’« agriculture québécoise » qui était menacée, mais plutôt ceux qui détiennent les droits et obligations de produire! S’il avait voulu protéger l’agriculture québécoise, M. Groleau aurait permis aux petits agriculteurs de produire des quantités décentes d’œufs et de poulets, par exemple. Une fois de plus, l’UPA réitérait sa fonction : défendre les intérêts d’une poignée de joueurs privilégiés.
Accessoirement, pour compenser l’arrivée des 28 millions de poulets sur nos marchés, il faudrait, dans les circonstances de production actuelle, voir naître 95 000 petits producteurs de volailles (légalement limités à une production maximale de 300 têtes annuellement). Or, il ne faut pas naïvement espérer qu’un nombre aussi grand de producteurs voit le jour de sitôt. Et partant de ce constat, on peut affirmer à nouveau que l’UPA, et les lois qu’elle protège pour asseoir ses privilèges, vont complètement à l’encontre de la souveraineté alimentaire.
Mettre fin au monopole syndical de l’UPA
Or, la souveraineté alimentaire doit nécessairement passer par une réactualisation de la gestion de l’offre. Mise en place dans les années 1970, elle n’a pas su s’adapter à la réalité changeante d’une planète nouvellement mondialisée. Mais s’en prendre à la gestion de l’offre demande nécessairement une confrontation avec son chien de garde, celui qui répond au nom de UPA. Et si cette organisation demeure la seule légalement en droit de représenter l’intérêt de tous les agriculteurs, la tâche de réfléchir les mécanismes qui assureraient la souveraineté alimentaire sera ardue, voire impossible! De ce fait, modifier la gestion de l’offre implique aussi de mettre fin au monopole syndical de l’UPA. Les citoyens et paysans doivent s’unir : brisons cette entité qui perpétue l’agriculture industrielle et prenons en main notre destin!